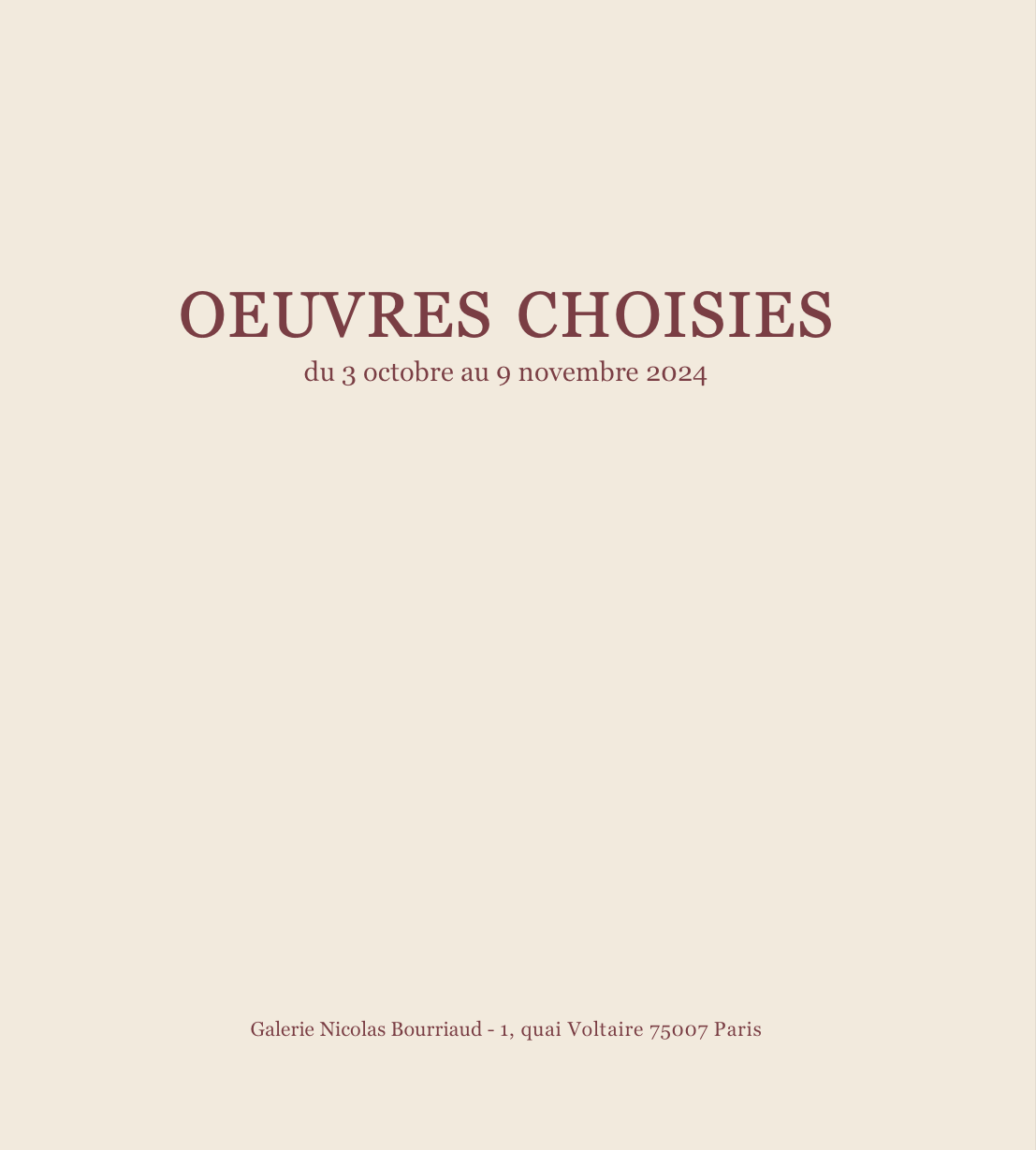
du 3 octobre au 9 novembre 2024
Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui pour notre troisième édition d’Œuvres choisies 1 quai Voltaire. Pour cette occasion, les grands noms de la sculpture sont réunis.
Commençons par Antoine-Louis Barye et son Éléphant écrasant un tigre (1847), un bronze très rare dont le tirage du vivant ne comprend qu’une quinzaine d’exemplaires. Ici encore Barye nous surprend par la violence du combat et la force du modelé. Dans un tout autre esprit, citons la Danseuse juive, famille syro-arabe, type caucasique (1856) de Charles Cordier, une sculpture emblématique du sculpteur qu’il a proposée seule ou accompagnée de la Danseuse mauresque et du Musicien turc. Il s’agit d’un modèle particulièrement gracieux sur lequel Cordier a posé un regard d’ethnologue mais aussi d’artiste confirmé donnant corps àl’idée d’une Antiquité biblique demeurée vivante en Orient. Une œuvre importante d’Auguste Rodin, Danaïde, taille originale dit aussi « petit modèle »- version type 1, (1885) vient ponctuer cette sélection du XIXe siècle. La nuque est découverte, la chevelure éparse, qui se confond avec l’eau, les courbes féminines opposent leur douceur et leur aspect poli comme de l’ivoire aux rochers laissés bruts avec les traces d’outils. Auguste Rodin ne choisit pas, comme dans l’iconographie traditionnelle, le moment du remplissage de la jarre, qui disparaît sous le corps épuisé, mais celui du désespoir devant l’inanité de la tâche. Le poète Rainer Maria Rilke écrivait que sa chevelure « liquide » se confondait avec l’eau s’écoulant de la jarre alors qu’elle reposait la tête « comme un grand sanglot sur son bras ».
Pour illustrer le XXe siècle, notre Jeune fille à la cruche ou Porteuse d’eau (1910) de Joseph Bernard, dont Luc Benoist affirma à plusieurs reprises qu’elle faisait date dans l’histoire de la sculpture. Notre exemplaire numéroté « 24 », magnifique fonte de Hébrard, en est la parfaite illustration, le sculpteur cherchant toujours à obtenir une parfaite pondération des masses alors même qu’il saisit sa figure en marche. De la même génération Paul Landowksi et son célèbre Pugiliste (Georges Carpentier) (1920) grand modèle que l’artiste définissait comme « une magnifique machine humaine ». Cette sculpture est un antique par la pose, par le costume pudiquement réduit au strict minimum et c’est un moderne par le regard insoumis face à l’adversité que le sculpteur lui a modelé.
Toujours fidèle aux animaliers des années Trente, nous présentons une œuvre forte de Maurice Prost Tête de panthère, profil droit réalisée sur ardoise dont on pense qu’elle aurait servi de plaque signalétique de son atelier de la Tombe Issoire. Édouard-MarcelSandoz est une nouvelle fois au rendez-vous avec un de ses animaux de prédilection, le Lapin en boule sur socle. Il démontre ainsi son adage qui est le sien : « Décorer, c’est en somme la fin de tout art ».
D’autres artistes moins connus mais tout aussi intéressants tels que Raphaël-Schwartz Grande baigneuse et André Bizette-Lindet Femme assise nous proposent des figures sereines dont la nudité vient reposer notre regard capté par le choix des matières, ici un bronze et là un plâtre aux dimensions voluptueuses. En guise de conclusion, une sculpture surprenante, d’une grande force vitale, le Masque de Babet d’Émile Gilioli, figure incontournable de la sculpture abstraite des années 50.
Cette nouvelle sélection saura, je l’espère, vous donner un aperçu de ma quête d’exigence dans le choix des sculptures et de leur qualité technique et esthétique irréprochables.
Nicolas Bourriaud
